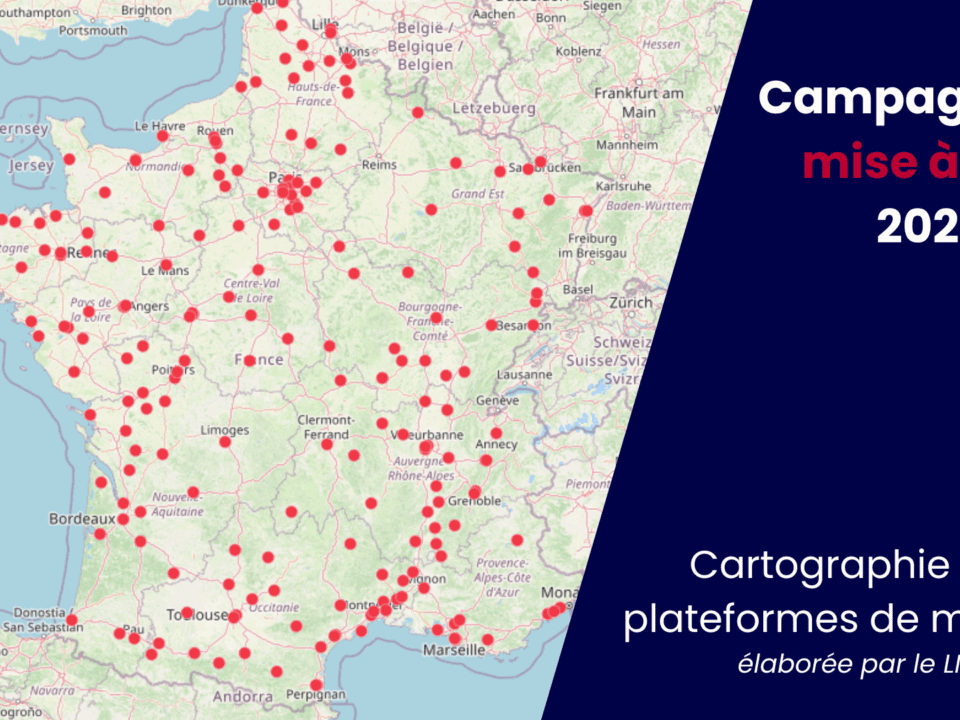[Interview] Louis Janvier, élève-administrateur à l’Institut national des études territoriales et Clément Gerber, élève ingénieur en chef à l’Institut national des études territoriales
![[Interview] Louis Janvier, élève-administrateur à l’Institut national des études territoriales et Clément Gerber, élève ingénieur en chef à l’Institut national des études territoriales [Interview] Louis Janvier, élève-administrateur à l’Institut national des études territoriales et Clément Gerber, élève ingénieur en chef à l’Institut national des études territoriales](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/uploads/2025/05/interview-1.png)
L’étude récente AFL-INET 2025, intitulée « Financer la transition vers des mobilités soutenables et équitables », tire la sonnette d’alarme : les autorités organisatrices de la mobilité devront faire face à un mur budgétaire de 55 milliards d’euros d’ici 2030 pour répondre aux objectifs climatiques et sociaux. À partir d’un diagnostic territorial fin, les auteurs alertent sur un modèle de financement à bout de souffle et appellent à une refonte ambitieuse qui intègrerait fiscalité écologique, tarification sociale et investissements publics. Rencontre avec Louis Janvier – élève-administrateur à l’Institut national des études territoriales (INET) – et Clément Gerber – élève ingénieur en chef à l’Institut national des études territoriales, co-auteurs de l’étude.
Comment avez-vous construit votre étude sur la mobilité équitable ?
Clément Gerber : Nous avons voulu croiser plusieurs approches – territoriale, sociale, écologique – en concentrant notre étude sur les déplacements domicile-travail. C’est un angle central, car il représente la majorité des trajets quotidiens et 98 % des émissions de CO₂ du secteur.
Louis Janvier : Nous avons travaillé sur trois types de territoires : urbain dense, périurbain et rural. Nous avons aussi intégré des spécificités comme l’outre-mer ou la montagne. Cette diversité d’approche nous a permis d’objectiver les disparités, mais aussi de proposer des réponses différenciées selon les contextes locaux.
Vous avez choisi d’étudier la mobilité sous l’angle de l’équité. Pourquoi ce choix ?
CG : Parce que la mobilité n’est pas qu’une question d’infrastructures ou de technologie. C’est un enjeu de justice. Or aujourd’hui, on observe un écart croissant entre ceux qui ont accès à une offre diversifiée et de qualité, et ceux qui restent captifs de leur voiture ou limités dans leurs déplacements. C’est un révélateur des inégalités sociales et territoriales.
LJ : On voulait sortir d’une approche uniquement technique. En nous focalisant sur les trajets domicile-travail, on touche à la réalité du quotidien pour des millions de personnes, et à l’impact concret que peut avoir une politique publique bien pensée.
Quels sont les principaux résultats de l’étude ?
CG : L’étude révèle tout d’abord une dépendance massive à la voiture individuelle, en particulier dans les zones rurales. Alors que les objectifs de neutralité carbone pour 2050 se rapprochent, 86 % des ménages ruraux n’ont aujourd’hui aucune alternative crédible à la voiture, contre 46 % en milieu urbain. Cette fracture territoriale met en lumière une forte inégalité d’accès à la mobilité durable. Par ailleurs, le modèle actuel de financement – reposant principalement sur le triptyque versement mobilité, subventions publiques et recettes de billetterie – ne permettra pas de couvrir les besoins estimés à 100 milliards d’euros d’ici 2030. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) devraient faire face, dans ce laps de temps, à 25 milliards d’euros supplémentaires en dépenses de fonctionnement et 30 milliards en investissements. Du coup, cette situation crée un écart croissant entre les ambitions climatiques affichées et les capacités financières réelles des collectivités, en particulier dans les territoires les plus fragiles, qui sont paradoxalement aussi ceux où les besoins sont les plus criants.
Quelles sont les limites du modèle actuel de politique de mobilité ?
LJ : Il repose encore trop souvent sur l’extension de l’offre, en pensant que plus de bus ou plus de trains régleront tous les problèmes. C’est partiellement vrai, mais pas soutenable partout. Il faut aussi travailler sur le rapprochement des lieux de vie et d’emploi, repenser les horaires, développer le télétravail là où c’est possible, et agir sur l’organisation du territoire.
CG : On a aussi montré que l’électrification du parc automobile, si elle est nécessaire, ne suffira pas. Elle n’est pas accessible à tous, notamment pour les plus modestes. Il faut des solutions intermédiaires, plus sobres et collectives, comme le covoiturage, l’autopartage, ou les transports à la demande.
Quelles sont vos principales préconisations ?
LJ : Pour répondre à ce défi, il faudrait réformer le financement des mobilités en tenant compte des spécificités territoriales. Il ne s’agit plus d’un modèle unique, mais d’une logique différenciée, capable de s’adapter aux réalités urbaines, périurbaines et rurales. Dans le même temps il faudrait rééquilibrer les sources de financement : le versement mobilité, levier central pour les AOM, pourrait être élargi à de nouveaux contributeurs, modulé selon les zones et adapté aux réalités économiques locales. Par ailleurs, nous recommandons également de mieux flécher les recettes issues de la fiscalité écologique – telles que la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) ou les taxes sur les transports – vers les autorités organisatrices. Une autre piste évoquée est celle de la captation des plus-values foncières générées autour des pôles de transport, via une fiscalité spécifique ou des mécanismes de contribution, même si je reconnais que cette proposition est assez peu opérationnelle aujourd’hui car difficile à mettre en œuvre de façon lisible et n’est pas prioritaire par rapport aux autres actions possibles.
Dans votre étude, vous encouragez également le recours à la dette publique locale …
CG : Effectivement, mais de manière encadrée, pour anticiper les investissements nécessaires à la transition. En parallèle, nous plaidons pour une plus grande clarté des compétences et une gouvernance partagée entre l’État, les AOM, les entreprises et les citoyens. La participation citoyenne est d’ailleurs un levier clé de la réussite : diagnostic territorial, pédagogie locale et accompagnement au changement doivent faire partie intégrante des politiques de mobilité. Enfin, nous invitons les collectivités à renforcer les dispositifs de tarification sociale, voire à expérimenter la gratuité, notamment pour les publics fragiles. À condition toutefois d’en prévoir un financement stable et pérenne, pour ne pas fragiliser les services de mobilité.
Justement, comment intégrer les publics les plus précaires dans cette transition ?
CG : C’est un point central. Les ménages modestes consacrent souvent une part bien plus importante de leur budget à la voiture. En milieu rural, cela peut aller jusqu’à 20 ou 25 %. Et pourtant, ce sont aussi ceux qui ont le moins accès aux alternatives. Il ne faut pas que la transition écologique accentue cette fracture.
LJ : On plaide pour des politiques différenciées et progressives. Cela peut passer par des tarifications sociales ciblées, des aides à la conversion ou au covoiturage, ou encore par la mobilité solidaire, avec des acteurs associatifs qui accompagnent les publics en insertion. La clé, c’est d’aller vers eux, et de co-construire les solutions avec les acteurs locaux.
Quels rôles doivent jouer les collectivités dans ce changement ?
LJ :Un rôle de coordination avant tout. Elles doivent sortir de la logique d’opérateur de transport pour devenir des facilitatrices de mobilité. Cela veut dire animer un écosystème local, avec les employeurs, les associations, les habitants, et parfois même les grandes plateformes numériques.
CG : Et cela nécessite aussi des moyens adaptés. Aujourd’hui, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) n’ont pas toutes les mêmes capacités, ni en ingénierie, ni en budget. Il faut renforcer leur pouvoir d’agir, notamment dans les territoires ruraux ou périurbains. Sans compter qu’il existe aussi des leviers « à coût zéro », comme le décalage des horaires de cours à Rennes, qui a permis de lisser les heures de pointe dans les transports en commun. C’est ce type d’intelligence locale qui peut faire la différence.
Vous proposez une approche très territorialisée. Concrètement, que signifie une mobilité équitable sur le terrain ?
CG : Cela signifie que la même solution ne peut pas être appliquée partout. Une ligne de bus est efficace en zone dense, mais coûteuse et peu pertinente en zone rurale. Là, un transport à la demande ou du covoiturage organisé peuvent avoir beaucoup plus d’impact.
LJ : C’est aussi une question de priorisation. L’euro investi à Paris ne produit pas les mêmes effets qu’à Millau (12) ou à Mende (48). Une politique équitable, c’est celle qui réduit les écarts, pas celle qui alimente les zones déjà favorisées.
Quels sont les leviers de financement identifiés ?
CG : Nous avons identifié plusieurs leviers mobilisables à court et moyen terme. Le premier reste le versement mobilité, qui pourrait être modulé géographiquement et étendu à des structures jusqu’ici non concernées (plateformes de type Airbnb, pôles logistiques, grands hubs de transport). La fiscalité écologique, aujourd’hui peu fléchée vers les mobilités locales, pourrait être mieux répartie : taxe sur les carburants, sur les billets d’avion ou contribution kilométrique pour les poids lourds sont autant de pistes à explorer. Autre levier important : la valorisation foncière. Il s’agirait de mettre en place des dispositifs permettant aux collectivités de capter une partie de la hausse des prix immobiliers induite par les projets de transport. Enfin, comme nous le disions, il ne faut pas sous-estimer le rôle de la dette locale – à condition d’un encadrement rigoureux – et la nécessité de renforcer les mécanismes de subvention et de péréquation entre territoires. L’enjeu est d’assurer une véritable équité dans l’accès à la mobilité, quel que soit le territoire.
Lien utile :
https://www.agence-france-locale.fr/app/uploads/2025/04/etude-inet-afl-2025_v4_compressed.pdf





![[Replay] Webinaire Tous Mobiles – Episode #20 : Mobilité solidaire et Santé [Replay] Webinaire Tous Mobiles – Episode #20 : Mobilité solidaire et Santé](https://www.mobiliteinclusive.com/wp-content/smush-webp/2025/12/Vignette-webinaire-2-REPLAY_EP20-960x720.jpg.webp)